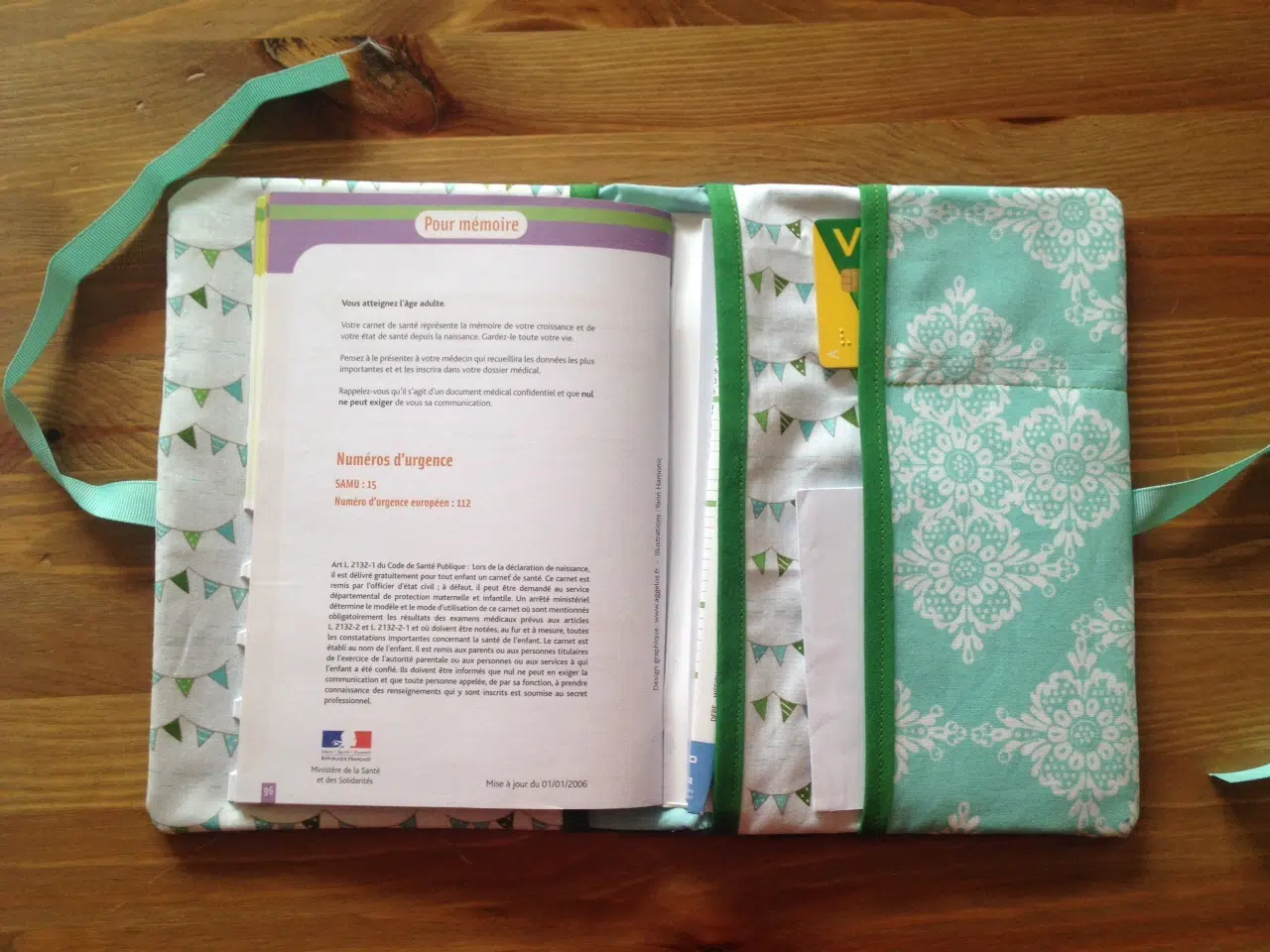Le taux d’exclusion scolaire des filles atteint encore 16 % dans certains États membres du G20, malgré des engagements internationaux répétés. Les disparités entre zones rurales et urbaines persistent, tandis que l’accès à l’éducation secondaire reste limité dans plus de 40 pays.
Des lois adoptées en 2023 n’ont pas suffi à inverser la tendance dans plusieurs régions d’Afrique de l’Ouest et d’Asie du Sud. Le soutien des agences onusiennes, combiné à des politiques locales ambitieuses, commence toutefois à produire des avancées tangibles, visibles dans les indicateurs publiés par l’UNICEF et l’UNESCO début 2025.
Pourquoi l’éducation des filles reste un défi mondial en 2025
Dans la réalité de 2025, la scolarisation des filles reste l’un des plus grands défis à relever pour la protection de l’enfance. Les organisations internationales, de l’Unicef à l’OMS, placent ce combat au sommet de leurs priorités. À la lecture du tout dernier Indice de Concrétisation des Droits de l’Enfant (ICDE), la sentence tombe : aucun pays ne parvient à garantir pleinement la santé et l’avenir de ses enfants. Les classements mondiaux couronnent la Norvège, la Corée du Sud ou encore les Pays-Bas, suivis de près par la France et l’Irlande. Mais l’écart avec la République centrafricaine, le Tchad, la Somalie ou le Niger reste vertigineux.
En Afrique subsaharienne, la situation demeure alarmante : cette région concentre encore 70 % des décès maternels mondiaux. En 2022, près de 330 millions d’enfants vivaient dans l’extrême pauvreté, dont une part importante de filles forcées de quitter l’école pour soutenir leur famille. La pandémie de COVID-19 a laissé des traces durables : la pauvreté a explosé, la malnutrition progresse, les retards scolaires s’accumulent. L’Unicef estime que 27 % des enfants de moins de cinq ans ont souffert d’une grave pauvreté alimentaire en 2022.
Mais les difficultés ne s’arrêtent pas là. Pollution et changement climatique viennent aggraver la fragilité des plus jeunes, en particulier des filles. Dans 43 pays de l’OCDE et de l’UE étudiés par l’Unicef, l’exposition aux risques environnementaux pèse lourdement sur l’éducation, la santé et la sécurité. Les progrès observés dans certains États demeurent fragiles. À l’échelle mondiale, la capacité à offrir un vrai avenir aux enfants dépend d’une combinaison complexe : politiques nationales volontaristes, contexte socio-économique, et soutien des acteurs internationaux.
Quels obstacles freinent encore l’accès à l’école pour les filles ?
Les freins à l’éducation des filles s’accumulent, et la pauvreté reste en tête de liste, notamment en Afrique subsaharienne. D’après l’Unicef, près de 330 millions d’enfants vivaient dans l’extrême pauvreté en 2022. Dans les familles les plus démunies, l’école passe au second plan. Les filles, bien souvent, quittent le système scolaire prématurément, absorbées par les tâches domestiques ou poussées vers un mariage précoce.
La crise du COVID-19 a amplifié ces inégalités. Fermetures d’écoles, pertes de revenus pour les parents, accès aux soins de santé restreint : autant de facteurs qui ont plongé des millions de foyers dans une précarité encore plus grande. Selon l’Unicef, 27 % des enfants de moins de cinq ans ont été confrontés à une grave pauvreté alimentaire en 2022. Malnutrition chronique et difficultés d’apprentissage vont de pair, renforçant ce cercle vicieux de l’exclusion scolaire.
D’autres obstacles pèsent sur la balance : l’accès à des infrastructures scolaires dignes demeure inégal. Manque de sanitaires séparés, insécurité sur le trajet de l’école, absence d’enseignantes qualifiées : autant de facteurs qui découragent les familles d’envoyer leurs filles à l’école. À cela s’ajoutent pressions sociales et traditions locales. Dans plusieurs régions, l’éducation des filles reste négligée, malgré les efforts de sensibilisation menés par l’OMS et l’Unicef.
Un chiffre interpelle : 70 % des enfants de dix ans dans les pays à faible revenu ne maîtrisent pas la lecture d’un texte simple. Au-delà du pourcentage, c’est la faillite des systèmes éducatifs à répondre aux besoins des plus vulnérables, notamment les filles, qui se révèle ici.
Zoom sur les pays les plus engagés : initiatives inspirantes et progrès mesurés
Dans ce contexte, certains États tirent leur épingle du jeu et montrent la voie. La Norvège, la Corée du Sud et les Pays-Bas occupent la tête du classement mondial pour la protection de l’enfance et la promotion de la santé. L’ICDE distingue ces pays pour la cohérence de leurs politiques publiques et les résultats obtenus sur le terrain.
Prenons les Pays-Bas : ici, le système d’aides sociales soutient concrètement les familles, avec des allocations généreuses, un accès universel à la santé et des dispositifs d’accompagnement spécifiques dès la petite enfance. En Corée du Sud, l’accent est mis sur l’éducation et la prévention médicale, et les effets sont mesurables.
La France se classe quatrième, devant l’Irlande, portée par un solide réseau de crèches publiques, un suivi sanitaire scolaire rigoureux et la gratuité de l’école primaire. Le Japon s’illustre comme le pays le plus sûr pour les enfants, affichant le taux d’obésité infantile le plus faible au monde. L’attention portée à la qualité des repas scolaires et à l’activité physique y contribue largement.
D’autres pays multiplient les approches. Pour donner un aperçu des initiatives remarquées ces dernières années :
- L’Estonie s’appuie sur la qualité de son enseignement et la formation des enseignants.
- La Finlande valorise les espaces verts urbains et le bien-être à l’école.
- L’Espagne progresse grâce à une faible pollution de l’air et de l’eau.
Neuf pays seulement, dont la Tunisie, l’Uruguay et le Vietnam, parviennent à associer réduction des émissions de CO2 et bon niveau d’épanouissement pour les enfants. Un équilibre qui démontre que conjuguer protection de l’enfance et transition écologique reste une ambition complexe, et pourtant réalisable.
L’action de l’UNICEF et des acteurs internationaux pour transformer l’avenir des filles
Sur le terrain, l’Unicef joue un rôle central pour défendre les droits des filles, souvent en première ligne face à la pauvreté et aux crises humanitaires. Depuis ses sièges à New York et Paris, l’organisation coordonne une multitude d’acteurs : gouvernements, ONG, fondations privées, tous mobilisés pour apporter des solutions concrètes là où les besoins sont les plus pressants. Le Forum de Paris sur la Paix a donné naissance au Cadre global prioritaire pour l’enfance, avec la volonté de remettre santé, éducation et nutrition au cœur des politiques publiques.
Dans cette dynamique, l’alliance entre Unicef, OMS et des partenaires comme la Fondation Gates structure une mobilisation internationale à la fois exigeante et pragmatique. Les interventions se concentrent dans les pays où les reculs scolaires et l’accès aux soins frappent d’abord les filles, en particulier en Afrique subsaharienne. Objectif affiché : renforcer les systèmes éducatifs et sanitaires pour faire face à toutes les urgences, de la pandémie à l’aggravation du changement climatique.
Ce soutien ne s’arrête pas à l’envoi de fonds ou d’experts. Il se traduit aussi par des missions de terrain, des programmes de formation pour les bénévoles, un accompagnement psychosocial et la distribution de matériel scolaire. Chaque initiative vise à améliorer la sécurité, l’accès aux soins et la possibilité, pour chaque fille, de rester à l’école. Les progrès sont suivis de près grâce à l’Indice de Concrétisation des Droits de l’Enfant (ICDE), qui met aussi en lumière la persistance de profondes inégalités.
L’avenir des filles, aujourd’hui, se joue à la croisée de la volonté politique, de l’engagement international et d’actions concrètes sur le terrain. Leur droit à apprendre, à grandir et à choisir leur vie n’a jamais été aussi débattu, ni aussi décisif. Les progrès engrangés n’effacent pas les défis, mais ils prouvent qu’un autre horizon reste possible.